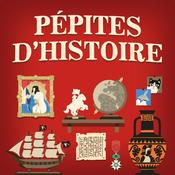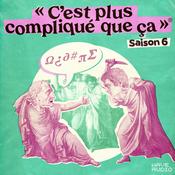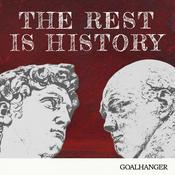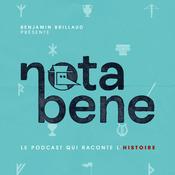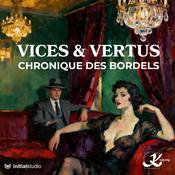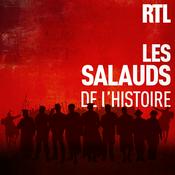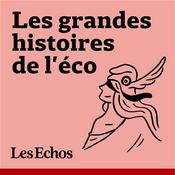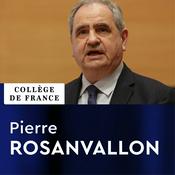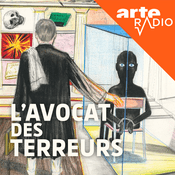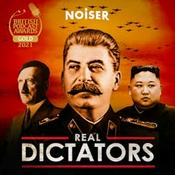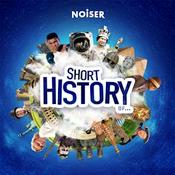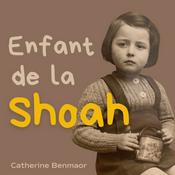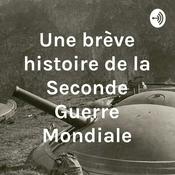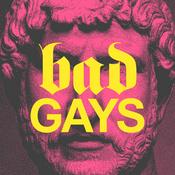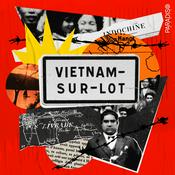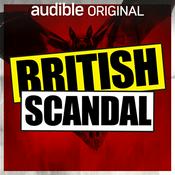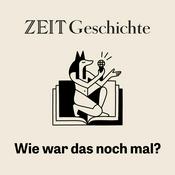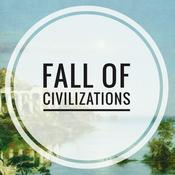Religion, histoire et société dans le monde grec antique - Vinciane Pirenne-Delforge
Collège de France

Dernier épisode
89 épisodes
Séminaire - Pierluigi Lanfranchi : Le sacrifice animal chrétien : histoire et anthropologie d'un rituel méconnu
11/2/2026 | 2 h 51 minVinciane Pirenne-Delforge
eligion, histoire et société dans le monde grec antique
Collège de France
Année 2025-2026
Pierluigi Lanfranchi
Université d'Aix-Marseille
Séminaire - Pierluigi Lanfranchi : Le sacrifice animal chrétien : histoire et anthropologie d'un rituel méconnu01 - Dans les cités : la Grèce comme culture sacrifiante : Sacrifier dans les cités : ouverture
05/2/2026 | 1 h 4 minVinciane Pirenne-Delforge
Religion, histoire et société dans le monde grec antique
Collège de France
Année 2025-2026
01 - Dans les cités : la Grèce comme culture sacrifiante : Sacrifier dans les cités : ouverture
Résumé
Cette leçon d'ouverture s'appuie sur un traité intitulé la Rhétorique à Alexandre, daté entre 340 et 300. De ce texte peu exploité par les historiens de la Grèce, Pierre Chiron a livré une édition de référence aux Belles Lettres en 2002. Le traité se penche sur les discours délibératifs que l'on produit au conseil ou à l'assemblée, qui sont les organes essentiels de la vie politique d'une cité grecque, dont Athènes où s'ancre le texte. L'ordre du jour de ces instances comporte divers points, dont le premier est celui qui touche aux hiera, aux « affaires sacrées », c'est-à-dire à ce qui concerne les dieux. Il apparaît d'emblée que ces « affaires » tournent essentiellement autour de la célébration des sacrifices et de la manière dont la cité légifère à leur propos, avec toute la rigoureuse souplesse requise par un système traditionnel non dogmatique. L'analyse de cette argumentation offre l'opportunité rare de saisir la pragmatique des sacrifices dans la réflexion officielle des organes politiques. La leçon met également ces arguments en regard de témoignages variés par leur chronologie, leur genre et leurs objectifs. Ce type de croisement documentaire atteste la pertinence de parler de Grèce sacrifiante : il s'agit d'une compétence culturelle qui traverse les siècles.11 - La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante : Sacrifices tragiques (2)
30/4/2025 | 57 minVinciane Pirenne-Delforge
Collège de France
Religion, histoire et société dans le monde grec antique
Année 2024-2025
La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante
11 - Sacrifices tragiques (2)
Résumé
Après une incursion dans les tragédies qui évoquent des sacrifices humains, ce sont les sacrifices animaux qui sont analysés dans trois tragédies : l'Agamemnon d'Eschyle, l'Électre d'Euripide et l'Antigone de Sophocle. L'Agamemnon, où était décrit le sacrifice humain d'Iphigénie jusqu'au moment de la porter au-dessus de l'autel, évoque également des sacrifices d'animaux qui sont autant de dispositifs sociaux aisément reconnaissables sous la forme d'actions de grâce aux dieux de la cité ou de la maisonnée. Mais là encore, la perversion du processus est la clé de leur place dans l'intrigue et ces opérations sont analysées, que ce soient les offrandes de Clytemnestre à tous les dieux de la cité à l'annonce du retour d'Agamemnon, ou le sacrifice de bienvenue au roi et d'intégration de Cassandre à l'autel de Zeus Ktèsios, qui se transforme en double meurtre. Dans l'Électre d'Euripide, deux sacrifices aboutissent également à des meurtres : celui d'Égisthe aux Nymphes est interrompu quand Oreste le met à mort au-dessus du jeune bovin immolé pour les déesses, et celui de Clytemnestre s'inscrit dans le cadre trompeur d'un sacrifice de bonne naissance qui se solde par la chute du corps de la reine sur le cadavre de son amant. Enfin, dans l'Antigone, le devin Tirésias, très inquiet des mauvais présages qui lui arrivent par le biais des oiseaux, entame un sacrifice divinatoire qui tourne très mal : la part des dieux refuse de brûler et c'est la traduction concrète, effrayante, de la rupture de communication entre la cité et ses divinités.10 - La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante : Sacrifices tragiques (1)
30/4/2025 | 59 minVinciane Pirenne-Delforge
Collège de France
Religion, histoire et société dans le monde grec antique
Année 2024-2025
La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante
10 - Sacrifices tragiques (1)
Résumé
Dans le cadre de l'exploration du matériau poétique grec pour étudier la part des dieux en contexte sacrificiel, la tragédie est une pièce de choix. En effet, l'association entre tragédie et sacrifice est l'une des plus historiographiquement chargées qui soient, pour deux raisons au moins. Tout d'abord, la question des origines du sacrifice, qui a hanté la recherche sur le rituel depuis le milieu du XIXe siècle, a puisé à la tragédie grecque une partie de ses arguments. Puisque le mot tragédie signifie en grec « le chant du bouc », le genre tout entier a pu être articulé au cadre rituel de la mise à mort d'un animal. Ensuite, la perversion et le détournement des sacrifices tragiques qui conduit à mettre des humains à mort ont nourri l'intérêt, voire la fascination, des chercheurs modernes pour le sacrifice humain. S'il est bien une perversion de l'offrande sacrificielle, c'est celle-là, dont la présente leçon se saisit.
La mise à mort rituelle d'Iphigénie, rappelée par le chœur de l'Agamemnon d'Eschyle, est l'exemple le plus célèbre de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler un sacrifice humain. Au supplice d'Iphigénie requis par Artémis vient s'ajouter celui de Polyxène, réclamée par l'ombre d'Achille, dans l'Hécube d'Euripide. Ce ne sont pas les seules figures tragiques à s'inscrire dans un tel cadre, mais il faut reconnaître qu'elles sont paradigmatiques dans toute la tradition grecque elle-même, et dans l'historiographie ensuite. La pertinence de les considérer comme des « sacrifices humains » est analysée. Quant à la jeune fille anonyme mise à mort dans les Héraclides d'Euripide et le fils de Créon, Ménécée, qui se suicide dans les Phéniciennes, leur sort est scellé par d'antiques prophéties qui font respectivement de Perséphone et de la Terre les destinataires de leur sang pour sauver Athènes, dans le premier cas, et Thèbes, dans le second. Le lexique de ces différentes mises à mort, plus ou moins ritualisées selon les contextes, est analysé.09 - La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante : Tuer un bœuf : étiologie des Bouphonies
10/4/2025 | 59 minVinciane Pirenne-Delforge
Collège de France
Religion, histoire et société dans le monde grec antique
Année 2024-2025
La part des dieux : la Grèce comme culture sacrifiante
09 - Tuer un bœuf : étiologie des Bouphonies
Résumé
Le terme de Bouphonia désigne un sacrifice qu'accomplissaient les Athéniens lors des Dipolia ou Dipoleia, à savoir la fête de Zeus Polieus célébrée sur l'Acropole d'Athènes au début du mois de juillet. Sur le plan lexical, le nom du rituel associe un bovin (bous) et une mise à mort progressivement conçue comme un 'meurtre' (phonos). Le verbe bouphonein est attesté une fois dans l'Iliade (VII, 466) sans qu'une telle connotation morale ne soit perceptible, pas plus qu'elle ne l'est dans les quelques emplois de l'adjectif bouphonos dans la poésie archaïque et classique. Un mois Bouphoniōn apparaît dans le calendrier de certaines îles ioniennes, ce qui implique la célébration de Bouphonies en ces lieux à des périodes anciennes, mais indéterminées. Par ailleurs, le mois Boukatios et la fête des Boukatia sont documentés en Grèce centrale et renvoient également au fait de tuer (kainein) un bovin. Il est intéressant de constater que le bovin est le seul animal sacrificiel dont le nom entre en composition avec le lexique de la mise à mort, alors que d'autres espèces sont bien plus souvent impliquées dans ce type d'abattage rituel. Il faut dire que le sacrifice d'un bovin est prestigieux, coûteux, voire spectaculaire. Mais ce n'est pas la seule raison de cette mise en évidence lexicale.
Pour approfondir ce point, on se penche sur le sacrifice athénien pour Zeus Polieus. Il présentait en effet des traits remarquables qui en ont fait un objet de curiosité et d'interprétation dès l'Antiquité. Le dossier complexe qui en résulte mêle des évocations du rituel lui-même, avec un procès condamnant l'outil de la mise à mort, et une étiologie qui traduit les liens étroits entre labour et sacrifice. Car le bœuf, au-delà de son coût, n'est pas un animal sacrificiel comme les autres : il est l'auxiliaire potentiel de l'homme dans ses travaux des champs ou de transport de charges. C'est la construction rituelle de cette contradiction dont témoigne l'étiologie des Bouphonies, au sein des Dipolies qui rappellent aussi les principes constitutifs de la vie civilisée : les communautés humaines travaillent la terre pour se nourrir, honorent les dieux, font société au sein de l'entité que les Grecs appellent polis et dont, à Athènes en tout cas, Zeus Polieus assure la souveraineté aux côtés de sa fille divine sur l'Acropole.
Plus de podcasts Histoire
Podcasts tendance de Histoire
À propos de Religion, histoire et société dans le monde grec antique - Vinciane Pirenne-Delforge
Depuis 2017, Vinciane Pirenne-Delforge est titulaire de la chaire Religion, histoire et société dans le monde grec antique. Les différents termes de cet intitulé désignent les éléments constitutifs de l'enseignement de la chaire et des recherches qui le fondent. Ainsi, le recours aux méthodes éprouvées de la démarche historico-philologique et la mise à profit des apports de l'anthropologie historique permettent d'appréhender l'étroite imbrication de ce que nous appelons « religion » dans les différents aspects de la vie sociale, politique, culturelle, voire économique, du monde grec. Ce dernier est envisagé au sens large de tous les lieux où les Grecs se sont établis, par la fondation de cités.La religion grecque est un polythéisme, ce qui évoque d'emblée une multiplicité de figures divines. Mais la pluralité qu'exprime le terme ne concerne pas seulement les entités suprahumaines auxquelles les Grecs ont rendu hommage pendant presque un millénaire. Toutes les composantes de leur religion, des représentations aux pratiques, relèvent d'un large éventail de possibles, non pas fondés sur des dogmes ou sur une révélation, mais sur des normes culturellement déterminées et des traditions narratives. Afin de comprendre un tel foisonnement de dieux et de rituels, il convient d'en restituer soigneusement les contextes et de faire droit à la complexité d'une culture dont l'apparente familiarité est un héritage trompeur. L'objectif des recherches menées au sein de la présente chaire est précisément de rendre compte des lignes de force qui structurent l'imaginaire des Grecs, ainsi que des pratiques qu'il induit et qui le constituent.
Site web du podcastÉcoutez Religion, histoire et société dans le monde grec antique - Vinciane Pirenne-Delforge, Les grands dossiers de l'Histoire par Franck Ferrand ou d'autres podcasts du monde entier - avec l'app de radio.fr

Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités
Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités


Religion, histoire et société dans le monde grec antique - Vinciane Pirenne-Delforge
Scannez le code,
Téléchargez l’app,
Écoutez.
Téléchargez l’app,
Écoutez.