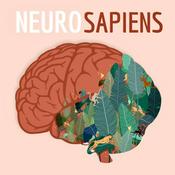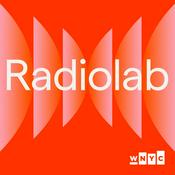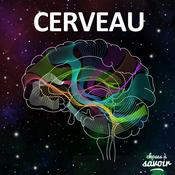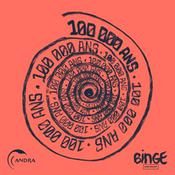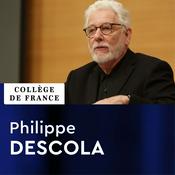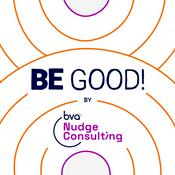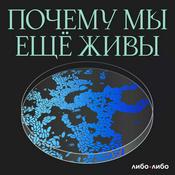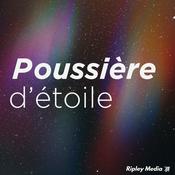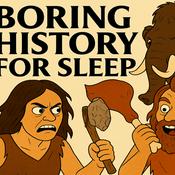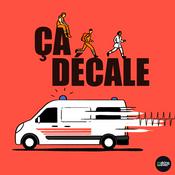Épisodes disponibles
5 sur 77
- #71 - Un historien à Gaza. Dialogue avec Jean-Pierre FiliuLe 28 octobre dernier, le Centre Marc Bloch avait l’honneur de recevoir Jean-Pierre Filiu pour une présentation de son livre Un historien à Gaza, à l’occasion de la parution de sa traduction allemande.Dans ce nouvel épisode de Radio Marc Bloch, Esther Möller, professeure d’histoire globale et ancienne directrice adjointe du Centre Marc Bloch, s’entretient avec Jean-Pierre Filiu autour de ce témoignage unique. Fruit d’une enquête de terrain menée entre décembre 2024 et janvier 2025, ce livre donne la parole aux habitants de Gaza, révélant leur résistance quotidienne pour la survie et la dignité, dans un territoire coupé du monde. L’échange aborde les conditions exceptionnelles de rédaction du livre et d'accès au terrain, la réalité d’un peuple abandonné, ainsi que la particularité de cette publication dans le contexte allemand. Jean-Pierre Filiu, professeur d’histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris et spécialiste de la région depuis 1980, offre une analyse à la fois historique et humaine de la situation à Gaza, nourrie par des décennies d’observation et d’engagement.Jean-Pierre Filiu. Un historien à Gaza. Les Arènes, 2025,Jean-Pierre Filiu, Ein Historiker in Gaza. Matthes & Seitz, 2025 (Deutsche Fassung)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------35:36
- #70-Das politisierte Fleisch: Jüdische und muslimische Perspektiven. Dialog mit Nur Yasemin Ural und Fabian WeberIn dieser Folge, moderiert von Esther Möller, diskutieren Fabian Weber und Nur Yasemin Ural über die Politisierung von Fleisch in historischer und aktueller Perspektive.Fabian Weber, Historiker für jüdische Geschichte, beleuchtet das rituelle Schlachten aus einer historischen und transnationalen Perspektive und macht deutlich, dass auch hier bis heute Vorstellungen von Zugehörigkeit und Differenz ausgehandelt werde.Die Soziologin Nur Yasemin Ural zeigt am Beispiel von Schweinefleisch, wie Fleisch zu einem affektgeladenen Thema wird, das religiöse Differenz – insbesondere die ‚muslimische Frage‘ – markiert und die Grenzen liberal-demokratischer Bürgerschaft verhandelt.Beide Wissenschaftler*innen betonen, wie wichtig es ist, die Perspektive der jeweils anderen Tradition einzubeziehen, um die eigene Forschung wirklich verstehen zu können.Literaturhinweise : Ural, N. Y. (2025). Affective Secularity. Secular Studies, 7(2), 202-221. https://doi.org/10.1163/25892525-bja10076Burchardt, M., & Yasemin Ural, N. (2024). The future of religious pasts: religion and cultural heritage-making in a secular age – introduction. Cultural Studies, 38(5), 717–732. https://doi.org/10.1080/09502386.2024.2363200Ural Nur Yasemin & Donovan O. Schaefer. Cultural Christianity’s Secular Cathedral, September 25, 2025. https://politicaltheology.com/cultural-christianitys-secular-cathedral/ Weber, Fabian. Projektionen auf den Zionismus. Nichtjüdische Wahrnehmung des Zionismus im Deutschen Reich 1897-1933 (2020)Weber, Fabian. "Armin Mohler, die Neue Rechte und der Antisemitismus 1950 bis 1995" Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, vol. 73, no. 2, 2025, pp. 253-289. https://doi.org/10.1515/vfzg-2025-0014Weber, Fabian. "Nur in anderem Gewand? Der alte Antisemitismus der „Neuen Rechten", 12.2025. InfoPool Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------54:46
- #69-On Displaying Violence: First Exhibitions on the Nazi Occupation in Europe, 1945–1948. A dialogue with Agata Pietrasik and Maciej GugalaIn the years immediately following the Second World War, European societies were confronted with a difficult question: how to show and explain the violence and destruction of Nazi occupation to a public still living among its ruins. One response came through a series of exhibitions created between 1945 and 1948 across Europe, often by survivors themselves. These exhibitions documented Nazi crimes and resistance using images, objects, and personal testimonies. They were not only about remembering, but also about shaping the political and moral foundations of postwar democracy.The current exhibition On Displaying Violence at the Deutsches Historisches Museum revisits these early attempts to represent violence and asks how exhibitions became tools for rebuilding societies.To explore these questions, Fabien Théofilakis, historian and deputy director of the Centre Marc Bloch, welcomes two of the curators of the exhibition at the German Historical Museum:Agata Pietrasik is an art historian and Alfred Landecker Lecturer at Freie Universität Berlin, and the curator of On Displaying Violence at the DHM.Maciej Gugała is a research associate at the Deutsches Historisches Museum and an art historian who contributed to the exhibition’s development.Publication references: Maciej Gugała, “Beyond Black and White: Tracing Colours of Postwar Exhibitions”, DHM-Blog, 13 August 2025, https://www.dhm.de/blog/2025/08/13/beyond-black-and-white-tracing-colours-of-postwar-exhibitions/· German version: “Jenseits von Schwarz-Weiß. Die Farben von Nachkriegsausstellungen entdecken”, https://www.dhm.de/blog/2025/08/13/jenseits-von-schwarz-weiss-die-farben-von-nachkriegsausstellungen-entdecken/Agata Pietrasik, Art in a Disrupted World: Poland, 1939-1949, First edition, New Histories of Art 2 (Academy of Fine Arts in Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 2021). Agata Pietrasik, “Exhibiting the Holocaust at the Majdanek Concentration Camp and the Bergen-Belsen DP Camp,” The Journal of Holocaust Research 37, no. 3 (2023): 271–96. Agata Pietrasik, “Exhibiting the Holocaust at the Majdanek Concentration Camp and the Bergen-Belsen DP Camp,” The Journal of Holocaust Research 37, no. 3 (2023): 271–96, https://doi.org/10.1080/25785648.2023.2210939. Agata Pietrasik, “On Display: Miscellaneous Objects in Early Holocaust Exhibitions in Poland,” Holocaust And Genocide Studies, September 2, 2025, dcaf026, https://doi.org/10.1093/hgs/dcaf026. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------58:26
- #68-Übersetzen mit emotionaler statt künstlicher Intelligenz ? Dialog mit Béatrice CostaTheaterspielen fürs Übersetzen? Warum sollten künftige Dolmetscher:innen Schauspielerfahrung haben? Was macht die subjektive Erfahrung szenischer Darstellung mit der Sprachpraxis? Ist emotionale Intelligenz wichtiger für Behördendolmetscher:innen als künstliche Intelligenz? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Béatrice Costa, assoziierte Professorin an der Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen der Université de Mons und im Sommer 2025 Fellow am Centre Marc Bloch.In der Serie „Par ailleurs – Desweiteren“ unterhält sich Alix Winter mit Béatrice Costa über aktuelle Entwicklungen in der Ausbildung von Dolmetscher:innen, über Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis und über Mobilität in der Wissenschaft.Weitere Informationen über Béatrice Costa finden Sie auf ihrer Webseite und wenn Sie sich über ihre Forschung informieren wollen, empfehlen wir folgende Publikationen:Costa, B. (2025, 20 mai). From text to stage: Exploring performance-based language work with student translators. Parallèles. [En ligne]. https://www.paralleles.unige.ch/fr/dernieres-contributions/costaCosta, B. (2023). Le théâtre comme outil de formation à l’interprétation de dialogue : Comment sensibiliser les apprenants-interprètes au dispositif théâtral. Parallèles, 35(2), 104–118. [En ligne]. https://www.paralleles.unige.ch/fr/tous-les-numeros/numero-35-2/costaCosta, B. (2021). "Habilitation à diriger des recherches. Le texte littéraire à l'épreuve du rythme. Réflexion littéraire et traductologique sur le processus de subjectivation dans le langage" [Doctoral thesis, Université Polytechnique Hauts-de-France]. ORBi UMONS-University of Mons. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/43057Meschonnic, H. (2021). "Henri Meschonnic : Ethik und Politik des Übersetzens. Aus dem Französischen von Béatrice Costa. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans Lösener und Vera Viehöver" (Costa, B., Trans.). Berlin, Unknown/unspecified: Matthes & Seitz.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------41:02
- #67-Une photo de famille éclatée : les Enfants de Simmel. Dialogue avec Denis Thouard et Barbara ThériaultDans ce nouvel épisode de Radio Marc Bloch, Jonas Nickel (doctorant au CMB) s’entretient avec le philosophe Denis Thouard (CMB/CNRS) et Barbara Thériault (sociologue, Université de Montréal) à l’occasion de la parution du livre Les enfants de Georg Simmel, réunis par Denis Thouard (Circé, 2024).Le point de départ de la discussion est une interrogation sur l’écriture de l’histoire intellectuelle lorsqu’elle n’est plus portée par des institutions, des « écoles » ou des courants constitués. Comment rendre compte de la postérité d’une pensée aussi singulière et marginale que celle de Georg Simmel, qui, à l’écart des cadres universitaires traditionnels, a pourtant profondément marqué la sociologie, la philosophie et les sciences de la culture ?Plutôt qu’une généalogie, Les enfants de Georg Simmel propose une métaphore photographique : celle d’un groupe réuni le temps d’une pose, saisi dans la contingence d’un moment commun. Ces « enfants » ne forment pas une famille intellectuelle au sens strict, mais un rassemblement de figures disparates, reliées par la trace laissée en elles par Simmel. Derrière l’individualisme exubérant de ces penseurs, un « air de famille » se dessine — celui d’une pensée vivante et relationnelle.À travers cet échange, Denis Thouard et Barbara Thériault reviennent sur ce que signifie aujourd’hui écrire une histoire des idées à la fois rigoureuse et sensible, attentive aux formes mineures de la transmission intellectuelle.L’épisode s’achève sur un extrait du Scherzino de Heinz Tiessen, autre figure issue de l’univers simmelien.Pour aller plus loin :Barbara Thériault, Abenteuer einer linkshändigen Friseurin, Leipzig, Edition Überland, 2024.Siegfried Kracauer, Culte de la distraction. Miniatures urbaines et critiques de films (1925-1933), préface de Philippe Despoix, traduit par Barbara Thériault et Sabine Cornille, Dijon, Les presses du réel, 2025.Denis Thouard, Georg Simmel. Une orientation, Belval, Circé, 2020.Réciprocités sociales. Lectures de Simmel, édité par Gregor Fitzi et Denis Thouard, Sociologie et sociétés 44, 2, 2012.Table des matières du livre les enfants de Georg Simmel Signalons également un article à paraitre sur l'ouvrage dans la revue Soziopolis ainsi qu'un entretien avec Denis Thouard dans le magazine SiggiAinsi que la parution en allemand de l'article de Sarah Kiani, Die vielen Gesichter des Hugo Marcus, ZlF Blog: https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2024/12/09/sarah-kiani-die-vielen-gesichter-des-hugo-marcus/Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------45:54
Plus de podcasts Sciences
Podcasts tendance de Sciences
À propos de Radio Marc Bloch
Radio Marc Bloch est un podcast produit par le Centre Marc Bloch (https://cmb.hu-berlin.de/fr/), le centre franco-allemand de sciences humaines et sociales situé à Berlin. Au travers de deux rubriques (Dialogues, et Partenaires), enregistrées en français, en allemand ou en anglais, Radio Marc Bloch vous permet de retrouver l'actualité de nos 250 chercheuses et chercheurs et de nos nombreux partenaires. Des conflits politiques à l’écologie en passant par les migrations, la globalisation ou la philosophie, nous aborderons sur cette chaîne une large palette de sujets pour examiner ensemble l’évolution de nos sociétés européennes. Bonne écoute, en espérant vous retrouver à la Friedrichstraße, au cœur de Berlin pour l'une de nos nombreuses manifestations!
Pour toute question, suggestion, commentaire, écrivez-nous à: [email protected]
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Site web du podcastÉcoutez Radio Marc Bloch, Hidden Brain ou d'autres podcasts du monde entier - avec l'app de radio.fr

Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités
Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités


Radio Marc Bloch
Scannez le code,
Téléchargez l’app,
Écoutez.
Téléchargez l’app,
Écoutez.