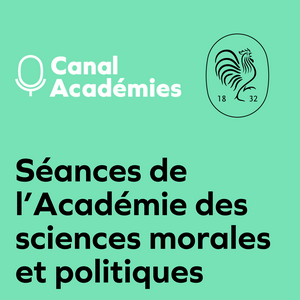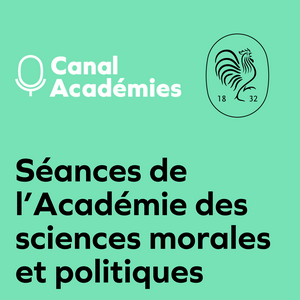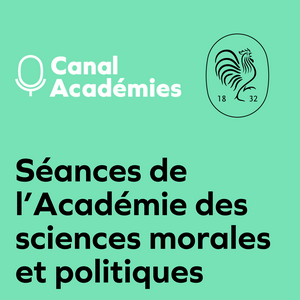Droit et géographie
La matinée du 2 juin 2025 s’est attachée à interroger les articulations entre le droit et la géographie, deux disciplines dont les connexions, bien que profondes, demeurent trop rarement explorées de manière systématique. L’initiative, saluée comme inédite, visait à susciter un dialogue interdisciplinaire fécond entre deux sociétés savantes fondées au XIXe siècle, entre juristes et géographes, autour des enjeux spatiaux du droit et de l’influence normative sur les territoires. Dans son propos introductif, Bernard Stirn, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a rappelé que si le droit entretient depuis longtemps des affinités naturelles avec l’histoire — comme en témoigne la célèbre formule de Montesquieu : « il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire » —, ses liens avec la géographie ont été beaucoup plus ténus. Pourtant, la pensée de Montesquieu elle-même appelait à considérer les lois comme relatives « au physique du pays », au climat, au sol et aux modes de vie. À cette fin, Bernard Stirn a proposé de renouveler l’approche du droit en affirmant la nécessité de « l’éclairer par la géographie et d’éclairer la géographie par le droit ». La géographie constitue un éclairage nécessaire du droit. La délimitation des domaines publics, la détermination des frontières étatiques ou encore l’application territoriale des normes juridiquess’appuient sur des considérationsspatiales comme en témoigne la portée toujours actuelle de l’ordonnance de Colbert de 1681 sur le rivage maritime, enrichie par la jurisprudence Kreitmann du Conseil d’État (1973), ainsi que le rôle structurant du droit international dans la définition des zones maritimes (eaux territoriales, ZEE, haute mer). De même, Bernard Stirn a souligné l’importance croissante de l’extraterritorialité des normes, notamment à travers les traités internationaux, les régimes juridiques régionaux comme l’Union européenne ou encore la diffusion de modèlesjuridiques(common law, charia, droit romain, droit chinois). Le droit, dès lors, se projette au-delà des frontières nationales, dessinant une cartographie normative en constante expansion. En retour, le droit contribue puissamment à structurer l’espace géographique. Il en organise l’occupation à travers le droit de l’urbanisme (depuis la loi Cornudet de 1919 jusqu’à la loi SRU de 2000) et participe à la protection de l’environnement et des paysages par le biais de normes dédiées (lois Montagne, Littoral, Air, Eau, Charte de l’environnement). Le droit de l’environnement en particulier illustre cette interpénétration croissante des logiques juridiques et géographiques, dans un contexte de préoccupations accrues pour le changement climatique et la biodiversité. Dans son intervention, François Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et président de la Société de législation comparée, a poursuivi cette réflexion en insistant sur le rôle central du droit comparé comme lieu de convergence entre le droit et la géographie. Rappelant la pensée de Montesquieu, il a souligné que les lois, pour être pleinement comprises, doivent être situées dans leur contexte historique, culturel et géographique. À l’instar des géographes, les juristes construisent des typologies, élaborent des classifications (droit continental, common law, droit musulman, droit coutumier) et utilisent des représentations cartographiques des systèmes juridiques.