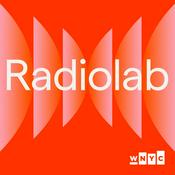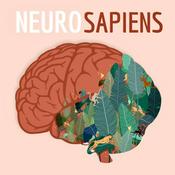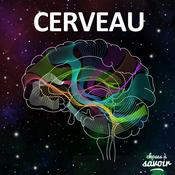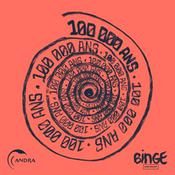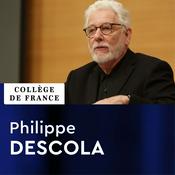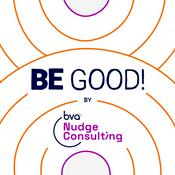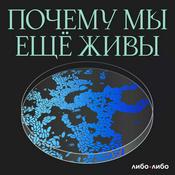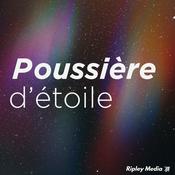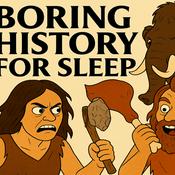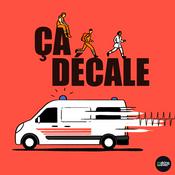Épisodes disponibles
5 sur 25
- [Plastique addict : comment s'en débarrasser ? #3] Remplacer le plastique pétrosourcé par du biosourcéDe plus en plus d’entreprises et de chercheurs sont en quête de solutions non ou moins impactantes que les polymères pétrosourcés. Et ce, en essayant d’atteindre les mêmes performances. Nos invités Charlène Béal-Fernandes, responsable communication et Lyes Chiheb, responsable développement durable chez Lactips, une entreprise qui produit des polymères naturels, témoignent.La caséine, un nouveau matériau bien connu [01:02 - 08:25]Réaliser des matériaux à base de caséine, la protéine de lait, n’est pas nouveau. La société Lactips utilise cette protéine pour la conception de ses polymères naturels, en s’appuyant sur les travaux réalisés par Frédéric Prochazka, enseignant chercheur au laboratoire Ingénierie des matériaux polymères de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne. Une protéine bien connue de l’industrie qui trouve aujourd’hui son intérêt dans la production de plastique. « C’est un changement de paradigme, le basculement vers des matières plus vertueuses, qui nous fait revenir à cette matière laissée dans un tiroir pendant des années » commente Lyes Chiheb responsable développement durable chez Lactips.Pour le comestible et les pièces outdoor [08:26 - 14:04]Aujourd’hui Lactips produit ce granulé thermoplastique, hydrosoluble et biodégradable pour concevoir différents produits tels que « des films pour une utilisation de courte durée, des étiquettes hydrosolubles pour le marché du réemploi, le revêtement des packaging alimentaires qui est aujourd’hui en plastique, mais également des produits pour des applications outdoor, comme les petites pièces en plastiques utilisées par les agriculteurs et qui ne sont pas systématiquement récupérées en fin de saison » illustre Charlène Béal-Fernandes, responsable communication chez Lactips.Peu de modifications pour les industriels [14:05 - 21:15]Le matériau est vendu sous la forme de granulé et ne nécessite pas de grosses transformations de la ligne de production, ni de nouvel investissement dans les machines. « Notre matière ne va pas se transformer à des températures similaires des conventionnelles, nous sommes à des températures beaucoup plus basses, ajoute Lyes Chiheb. Ce qui est positif d’un point de vue environnemental. » Le matériau est quant à lui plus cher que le plastique conventionnel, comme les autres matières biosourcées. « Aujourd’hui, nous avons un producteur de matière première français, qui se fournit avec des ingrédients français... ce qui est également un avantage pour les industriels dans un contexte géopolitique compliqué » ajoute-t-il. Sans oublier la réglementation qui pousse vers la fin des plastiques jetables. Références citées :- Frédéric Prochazka, co-fondateur et directeur scientifique de Lactips- Alexis von Tschammer, directeur général de Lactips- PHA ou polyhydroxyalcanoate- Le blend : un mélange de bioplastiques- Le produit CareTips®️ de Lactips- PE : polyéthylène, PP : polypropylène- PPWR : Proposal Packaging and Packaging Waste regulation- Le test CEPI de recyclabilité du papier. PTS Papiertechnische Stiftung Recherche et développement en matière de fibres- PLA : Polylactic Acid, matériau thermoplastique issu de sources biodégradables, qui n'est pas "home compost"Ressources pour aller plus loin :Expérimentation sur la biodégradation des emballages certifiés compostables en site de compostageChaire CopackMicrobial decomposition of biodegradable plastics on the deep-sea floor--------24:53
- [Plastique addict : comment s'en débarrasser ? #2] Renoncer au plastique jetable... Comment faire ?Difficile de se passer de plastique ? Pour le deuxième épisode de cette mini-série sur le plastique, nos invités Maïwenn Bégoc, consultante au cabinet de conseil Consultantseas spécialisé dans la prévention à la pollution plastique et Loïc Hénaff, PDG du groupe agroalimentaire Hénaff reviennent sur les aspects et les enjeux du travail mené ensemble sur l'utilisation du plastique et comment le réduire.Embarquer tout le monde dans le changement [03:13 - 09:03]Que l’on soit une TPE/PME, traquer les plastiques de son entreprise est possible. Mais dans cette transition vers des solutions moins impactantes, il est important d’embarquer tous les acteurs de la chaîne de valeur - clients, sous-traitants, etc. - mais également les employés qui devront mettre en œuvre les nouvelles solutions. « Nous faisons travailler ensemble les entreprises, des scientifiques, des ONG, des fournisseurs, des fabricants, les acteurs de la fin de vie, etc. » affirme Maïwenn Bégoc, consultante au cabinet de conseil Consultantseas spécialisé dans la prévention à la pollution plastique.Sur la chaîne de production et en interne [09:08 - 18:50]Car les plastiques, que l’on imagine avant tout sur les chaînes de production, sont également présents en interne : « nous utilisons peu de plastiques en production, mais beaucoup dans l’entreprise pour des raisons sanitaires, de protection, de solidité, de tenue de palette... » précise Loïc Hénaff, PDG du groupe agroalimentaire Hénaff. Pour parvenir à identifier l’ensemble des plastiques utilisés par l’entreprise, un diagnostic est réalisé sur les emballages mis sur le marché, les emballages secondaires et tertiaires, mais également ceux d’approvisionnement, de laboratoire, etc. « Ensuite, on vient prioriser et hiérarchiser les enjeux et les plastiques à traiter » ajoute Maïwenn Bégoc.Intégrer l’ensemble du cycle de vie [18:56 - 21:13]Lorsqu’un choix s’arrête sur une solution, il est important de vérifier la bonne gestion de sa fin de vie. « Quand nous avons basculé nos barquettes en RPET en partie recyclé et recyclable, nous étions persuadés qu’elles pourraient aller dans les sacs jaunes du tri, mais les centres de tri autour de chez nous les refusaient au début, explique Loïc Hénaff. Petit à petit, ils les ont acceptées. Et maintenant notre fournisseur est en train de participer à la création d’un centre de réutilisation de ces barquettes. »Et l’emballage consigné ? [21:17 - 30:10]Une autre solution pour les emballages à usage unique de l’agroalimentaire sont les barquettes en inox consignées, comme le propose la marque Berny. « L’emballage standard est une question clé pour le secteur agroalimentaire et facilitera le réemploi, ajoute Maïwenn Bégoc. Mais pour le moment, le potentiel sur ces produits reste faible. C’est pour cela qu’on encourage à considérer le réemploi sur tous les plastiques, notamment là où l’entreprise peut avoir la main, c’est-à-dire en interne. »Références citées :- Consultantseas- Hénaff- La société Berny- Surfrider - Tara Océan- Fondation Ellen MacArthur- Les Parcs Nationaux- Règles 5R / 3R : "Refuse, reduce, reuse, recycle, rot"- La boucle de réemploi, notamment de Citeo et la notion de transfert d'impact- Les études de l'AdemeRessources pour aller plus loin :- BeMed : analyse de terrain- "La stratégie du Y" par Alan FustecHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------33:11
- [Plastique addict : comment s'en débarrasser ? #1] Recyclés et biodégradables, une fausse bonne idée ?Pour faire face à la pollution plastique, des solutions alternatives sont mises en avant. Recyclés, biosourcés, biodégradables ou encore compostables... ces différents états sont-ils une bonne idée ? Voici les réponses de Raphaël Guastavi, directeur adjoint de la direction économie circulaire à l’Ademe, et le témoignage de Thomas Huriez, fondateur de 1083.L’industrie, addicte au plastique [01:17 - 04:06]Pour ses différentes caractéristiques, le plastique a largement été utilisé par l’industrie même lorsque ce n’était pas nécessaire. « On est passé à 15 millions de tonnes de plastiques produits dans les années 1960 à plus de 300 millions de tonnes aujourd’hui. En France, c’est 5 millions de tonnes de plastique produits pour 1,3 millions de tonnes » explique Raphaël Guastavi.Des solutions alternatives... plastiques [04:14 - 16:21]Recyclé, biosourcé, biodégradable ou encore compostable... « la meilleure solution alternative, c’est de réduire le plastique » insiste Raphaël Guastavi. Mais utiliser du plastique recyclé à la place d’une résine vierge est plutôt une bonne idée pour l’expert, notamment pour la réduction de son impact environnemental. Les matériaux biosourcés également, toujours en substitution de matière vierge « et en en utilisant des résidus de culture » précise-t-il. Pour le compostable, la solution doit être limitée à des cas très spécifiques.L’exemple du jean en plastique recyclé et recyclable [16:32 - 22:49]1083 conçoit un jean en polyester recyclé et qui est recyclable grâce à sa composition monomatière. En cherchant à développer ce jean, en s’intéressant aux potentiels fournisseurs , « on s’aperçoit que beaucoup de boutons sont en polyester recyclé, que le fil à coudre est très majoritairement en polyester et les étiquettes aussi peuvent l’être, explique Thomas Huriez. Il existait tout ce dont on avait besoin. Pour le moment, la boucle d’économie fermée n’est pas encore mise en route puisque les jeans vendus - consignés à 20 € pour favoriser le retour - ne sont pas, ou très peu, été retournés. Dès que la quantité de jean consignée reçu en retour client sera suffisante, et bien on va les effilocher pour les refondre et les mélanger dans la même filature et en faire un neuf » précise Thomas Huriez.Une compétition sur les matières [22:53 - 25:34]« Aujourd’hui, les résines de matières vierges sont abondantes et peu chères, ce qui rend la compétition difficile avec les matières recyclées plus cher » explique Raphaël Guastavi. « C’est vrai que sur une matière première très mûre à recycler comme les bouteilles plastique, il y a une forte tension car c’est très demandé commercialement, ajoute Thomas Huriez. Toutes les marques de boisson veulent montrer à leur client qu’elles font leur part de réchauffement climatique et que leurs bouteilles sont recyclées. » De ce fait, la demande est supérieure à l’offre, ce qui crée des tensions sur les matières premières.Références citées :- L'ademe- 1083- Le filateur espagnol Antex et le projet Seaqual- La gamme Infini de 1083Ressources pour aller plus loin :- Bilan sur 10 ans de recyclage, mars 2024, Ademe- Transition 2050, Ademe- Les feuilletons : "empreinte matière, empreinte carbone de la France", mars 2024, Ademe- La Permaindustrie, éditions Eyrolles Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.--------29:42
- [L’IA s’invite dans nos métiers #3] intégrer l’IA de façon éthique et règlementéePour comprendre les tenants et aboutissants du règlement européen sur l’intelligence artificielle, nous avons interrogé Jean-Gabriel Ganascia, informaticien et philosophe spécialisé dans l'intelligence artificielle et l’éthique à Sorbonne Université. Il est également membre du comité d’éthique du CNRS. Il nous partage également les bonnes questions à se poser avant de développer l’IA.C’est quoi l’IA Act ? [01:32 - 16:54]Le règlement européen IA Act, a pour objectif “de nous prémunir contre les dangers liés à l’intelligence artificielle” explique Jean-Gabriel Ganascia. Et ce, en introduisant la notion de risque qui est “l’éventualité d’un danger” ajoute-t-il. Ces risques sont catégorisés : inadmissibles (techniques subliminales, notation, biométrie en temps réel), élevés, modérés et faibles (filtres à spam, jeux vidéos).Pour l’instant il y avait peu de réglementation propre à chaque pays, et encore moins en France. Raison pour laquelle ce règlement est devenu important. Du côté des Etats-Unis et de la Chine, l’encadrement est très différent. Aux Etats-Unis, depuis juillet 2023, une réglementation enjoint les entreprises à développer l’IA pour le bien commun. En Chine, “le principe éthique sur lequel se reposent les réflexions c’est qu’il faut d’abord assurer la sécurité et la cohésion” précise l’expert.Des entreprises inquiètes [17:04 - 21:14]De nombreuses entreprises s’inquiètent de la complexité des règlements, avec des règles générales et contraignantes, ou encore des exceptions aux règles. En d’autres termes, “il faut des services juridiques compétents qui maîtrisent parfaitement cette réglementation pour guider [...] et pour des petites sociétés, c’est extrêmement difficile” regrette Jean-Gabriel Ganascia. Le règlement a d’ailleurs tardivement inclut l’IA générative, et en urgence, notamment avec l’arrivée de ChatGPT sur le marché.Intégrer l’éthique dans le développement [21:18 - 31:46]Faut-il se poser des questions sur l’éthique avant de se lancer dans le développement de l’IA ? Pour notre expert, les questions doivent se poser après la maîtrise des techniques d’IA mais avant la mise en œuvre des projets qui l’utilisent. “Sur chaque projet, il faut se demander quelles sont les conséquences et les dérives d’utilisation du système” précise le président du COMETS, en suivant une méthodologie précise en quatre points : réunir un comité d’éthique, se demander quelles sont les contraintes qu’on va s’imposer pour éviter les mauvaises utilisations, faire certifier par un organisme indépendant et garder une supervision. Et si vous ne savez pas comment faire pour mettre tout cela en place, il existe des formations !Références citées :Digital Service ActAI ActGrands modèles de Langage (ou Large Language Models, LLM)James Vicary (techniques subliminales)ChatGPTModèles de fondationRGPDTatouage, filigrane ou watermarkingX (ancien Twitter)InstagramRessources pour aller plus loin :Servitudes virtuelles, de Jean-Gabriel GanasciaWeapons of mass destruction, de Cathy O’NeilChronique éthiqueIA ActCogitons Sciences est un podcast produit par Techniques de l’Ingénieur. Cet épisode a été réalisé par Séverine Fontaine, en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet.--------32:49
- [L’IA s’invite dans nos métiers #2] Intégrer l’IA dans l'entreprise, pour un usage utile et raisonnéGain de temps, précision de prévision, un usage réfléchi de l'intelligence artificielle rend différents services et satisfait des besoins métiers. Certaines conditions garantissent un usage raisonné, comme l'éthique, l'humilité, la protection des données, tout cela dans le respect d'une certaine frugalité. Outre ces axes réflexions, Pierre Monget directeur de programme chez Hub France IA et Paul Hérent, cofondateur de Raidium, livrent leurs conseils en matière de développement de solution d'IA.C’est quoi, une IA utile et raisonnée ? [01:17 - 03:57]L’utilité est “avant tout de satisfaire un besoin qui rend service à une population d’utilisateurs et de manière plus large à la société” définit Pierre Monget. L’usage réfléchi, c’est se poser des questions tout au long du cycle de vie d’un outil d’IA, en partant des besoins métiers à la réalisation, “en visant un usage non absurde”, ajoute-t-il. “Est-ce vraiment nécessaire d’avoir une solution d’IA pour telle finalité ? Cette finalité est-t-elle vraiment utile ? N’est-elle pas absurde ? Les moyens mis en œuvre pour l’atteindre sont-ils raisonnés ?”L’exemple d’un outil médical [04:12 - 12:29]Raidium développe à la fois un modèle de fondation (IA générative) et une interface utilisateur (un viewer), permettant au radiologue d’améliorer son travail. Le modèle a appris le corps humain de la tête aux pieds ainsi que les connaissances médicales associées : anatomie normale et pathologique. Cet outil qui pourrait permettre à la fois de réduire les erreurs médicales et de démocratiser l’expertise radiologique, sans remplacer le radiologue, évidemment !Prendre en compte tout le cycle de vie [12:39 - 16:02]Que ce soit dans le développement ou l’utilisation finale de l’outil d’intelligence artificielle, chacun a sa responsabilité. Au-delà de questionner son utilité, il est important de prendre en compte l’impact environnemental tout au long de son cycle de vie : de son entraînement à sa mise œuvre. De plus, il est important que le modèle d’IA respectent les principes éthiques, la réglementation, et la bonne utilisation des données. “Sur quelles données va-t-on entraîner les modèles d’IA ? Sont-elles sensibles ? Personnelles ? A-t-on vraiment le droit d’y accéder ?” énumère Pierre Monget.Des compromis nécessaires [16:15 - 27:37]Développer un outil d’intelligence artificielle utile et raisonné, c’est aussi faire des compromis. Par exemple, utiliser un modèle plus léger et donc moins impactant pour l’environnement au prix d’une précision moindre lorsque cette dernière n’est pas nécessaire. Remettre en question, côté utilisateur, son utilisation de ChatGPT pour créer de simples images, par exemple. Ou encore, suis-je autorisé à copier du code source de mon entreprise dans des outils d’IA générative pour le debugger ? Certains ingénieurs ont essayé, ils ont eu des problèmes...Références citées :- Raidium- Viewer, outil de radiologie- Speech to text- Geoffrey Hinton - Deep Learning- Centre d'imagerie du nord, Saint-Denis 93- Coroscanner (Tomodensitométrie)- Open AI ChatGPT 3, 4- Large language model- Stable diffusion et MidJourney- AI ActRessources pour aller plus loin :- MOOC de Stanford sur le deep learning- AI Revolution in Medicine : GPT-4 and beyond de Peter Lee, Carey Goldberg, Isaac Kohane- L'Innovation Jugaad - Redevenons Ingénieux ! de Navi Radjou, Jaideep Prabhu et Simone Ahuja Cogitons Sciences est un podcast produit par Techniques de l’Ingénieur. Cet épisode a été réalisé par Séverine Fontaine, en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet.--------30:00
Plus de podcasts Sciences
Podcasts tendance de Sciences
À propos de Cogitons sciences
Cogitons sciences : le podcast de Techniques de l'Ingénieur qui décrypte les enjeux des sciences.
Au fil de mini-séries thématiques, le podcast Cogitons Sciences s’engage dans une réflexion critique sur l’avenir des sciences. Tous les premiers lundis du mois, les journalistes de Techniques de l'Ingénieur interrogent des spécialistes qui apportent leur expertise sur les enjeux futurs des sciences, dans des épisodes d’une quarantaine de minutes. Les énergies de demain, l’éthique des sciences, les métiers émergents... C’est aujourd’hui que tout se joue !
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Site web du podcastÉcoutez Cogitons sciences, Radiolab ou d'autres podcasts du monde entier - avec l'app de radio.fr
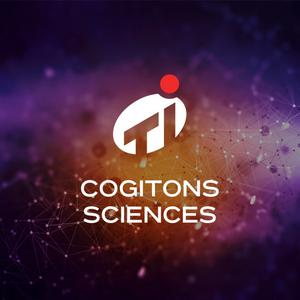
Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités
Obtenez l’app radio.fr gratuite
- Ajout de radios et podcasts en favoris
- Diffusion via Wi-Fi ou Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatibles
- Et encore plus de fonctionnalités

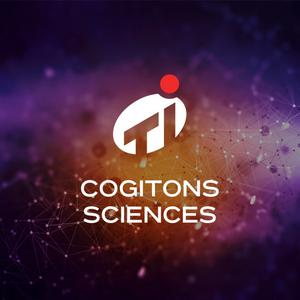
Cogitons sciences
Scannez le code,
Téléchargez l’app,
Écoutez.
Téléchargez l’app,
Écoutez.